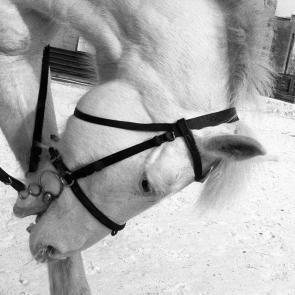Transsibériens Patrick Bard
Depuis 1916, date d’achèvement du dernier tronçon, le Transsibérien célébré par Blaise Cendrars relie Moscou à Vladivostok et Pékin. Si ce train de légende - le plus long du monde - est une formidable machine à rêver sur les traces de Jules Verne, Joseph Kessel et Andreï Makine, il est aussi un véritable magasin sur roues. Restait à embarquer à la gare de Iaroslav à bord d’un mythe vivant.
Le premier itinéraire, emprunté par le Rossiya, relie Moscou à Vladivostok. Le Transmandchourien rejoint Pékin par Harbin et le nord-est de la Chine. Le Transmongolien a lui aussi pour destination la capitale chinoise, mais via Oulan-Bator, les steppes mongoles, le désert de Gobi et la Grande Muraille. Sept mille huit cent soixante-sept kilomètres en un peu plus de six jours, neuf cent quatre vingt dix gares et six fuseaux horaires ! Le mythe tient en peu de mots.
Le convoi s’ébranle, il restera jusqu’à la frontière mongole à l’heure de Moscou et les passagers prendront de déroutantes habitudes, savourant après quelques jours leurs petits-déjeuners à deux heures du matin alors que sur les quais où se presse une foule tétanisée par la fièvre acheteuse, il en est sept et que déjà le soleil brille haut dans le ciel. Sous la canicule ou sous la neige, dans le froid sibérien, le paysage se déroule par la fenêtre comme un décor de cinéma - taïga, bouleaux, dodo - et les lambeaux de la grande Union Soviétique drapent leurs friches industrielles autour des villes comme une écharpe de rouille. Les haltes se succèdent rythmées par les bagarres des marchands ivres de vodka au wagon-restaurant : Ekaterinburg, théâtre de la fin tragique des Romanov, la traversée de l’Ienisseï, large comme l’Amazone, et qui court vers l’océan Arctique. Puis Novossibirsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, le lac Baïkal. Passée la douane mongole, c’est la steppe infinie jalonnée de yourtes, entre lesquelles galopent des cavaliers aux chapeaux pointus, puis Oulan-Bator, le Gobi et ses tempêtes de sable. Voici déjà la frontière chinoise. Bientôt la Grande Muraille et la gare de Pékin où le train, avec une ponctualité absolue se range le long du quai.
Eté comme hiver, ces six jours et six nuits filent à une vitesse effarante, cent kilomètres par heure de moyenne. Loin des insipides Trains à Grande Vitesse, ce roulant éloge de la lenteur qui fut pourtant en son temps un symbole de vitesse et de modernité laisse derrière lui l’ennui et la monotonie. Ici, point de gadgets, de wagons luxueux, ni de produits dérivés. Juste la vie et l’imprévu des rencontres. Une fois de plus, s’il fallait encore démontrer la justesse du mot de Stevenson, l’important n’est pas la destination, mais la déambulation, dont ce train reste l’un des vivants symboles.